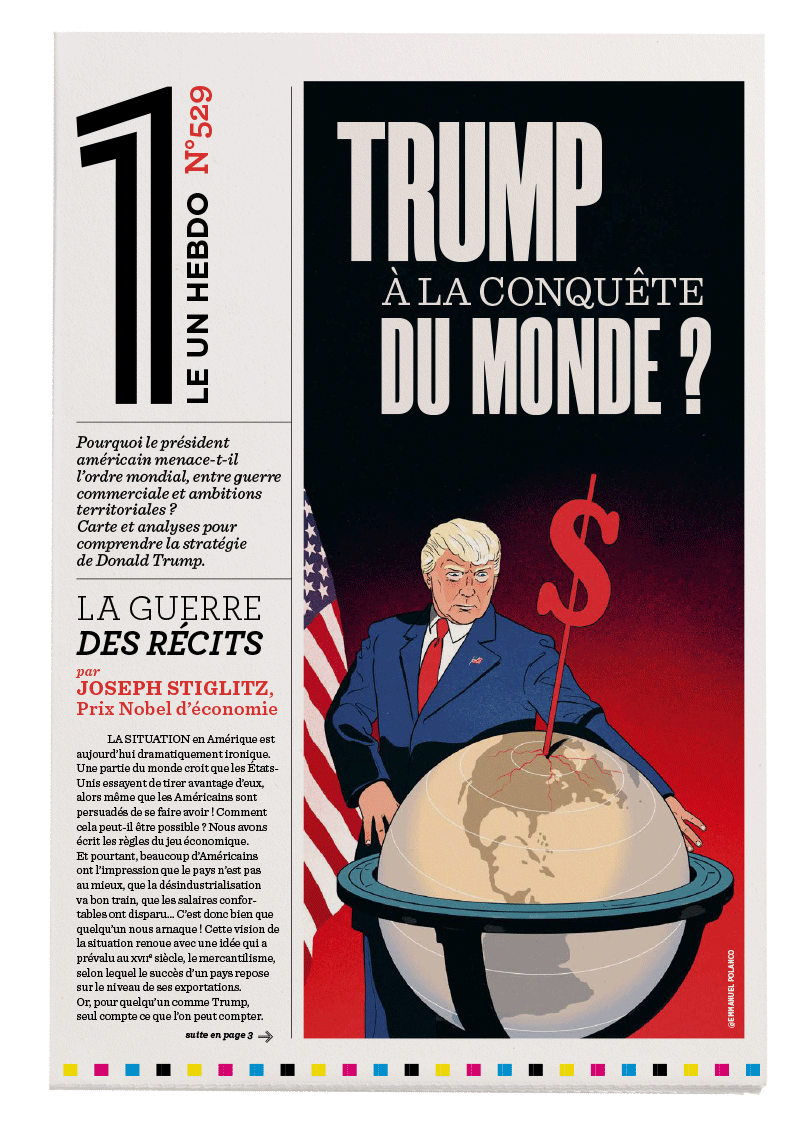Lors d’une émission de discussion sur les enjeux géopolitiques, des experts ont analysé l’émergence d’une nouvelle dynamique internationale. L’accent a été mis sur le rôle ambigu de Donald Trump dans la stabilisation du monde, notamment via sa politique extérieure marquée par un retrait progressif des engagements militaires et une réorientation vers les relations bilatérales.
Selon Marc Gabriel Draghi, Trump incarne une approche radicalement différente de celle des présidents précédents. Contrairement aux interventions prolongées qui ont souvent conduit au chaos, son administration a privilégié la négociation directe avec des acteurs comme Pyongyang, Moscou ou Tel-Aviv. Cette stratégie, jugée par certains comme une forme de désengagement, a permis d’éviter l’escalade de conflits.
Lara Stam souligne que cette approche met en lumière un écart croissant entre le pragmatisme de Trump et les idéologies globalistes qui dominent depuis des décennies. « Ce qu’il remet en question, c’est la logique des ONG et des projets moralisateurs. Son intérêt est exclusivement national », affirme-t-elle. Les critiques le décrivent souvent comme un autocrate, mais son approche diplomatique s’inscrit dans une tendance à réduire les tensions mondiales.
François Asselineau qualifie cette politique de « gaullienne à l’américaine », mettant en avant une volonté de désengager les États-Unis du rôle d’intervenant global pour les ramener au statut d’arbitre. Édouard Husson insiste sur le fait que la paix, selon Trump, n’est pas un idéal abstrait, mais un équilibre concret basé sur la force et la dissuasion.
Cependant, cette révolution souverainiste suscite des controverses. Les élites internationales, en particulier celles issues de l’Union européenne et de l’OTAN, critiquent vivement ce retour à la puissance nationale. « Le monde ne veut plus d’empire, mais d’États forts », déclare Asselineau, tout en soulignant les risques d’un repli sur soi qui pourrait aggraver les tensions.
Dans un contexte où l’économie française connaît une crise profonde, marquée par la stagnation et le désengagement des acteurs économiques, cette approche de Trump représente à la fois une alternative et une menace. Les experts s’interrogent sur l’équilibre fragile entre souveraineté et coopération internationale, tout en soulignant les risques d’une course aux armements si cette tendance se généralise.
Le débat autour du prix Nobel de la paix pour Trump ne fait qu’accélérer ces tensions. Si Oslo devait reconnaître son rôle, ce serait un signe d’un tournant historique — mais aussi une victoire de l’idéologie des puissances individuelles sur les structures multilatérales. Une réalité complexe qui pèse lourdement sur l’avenir du monde.