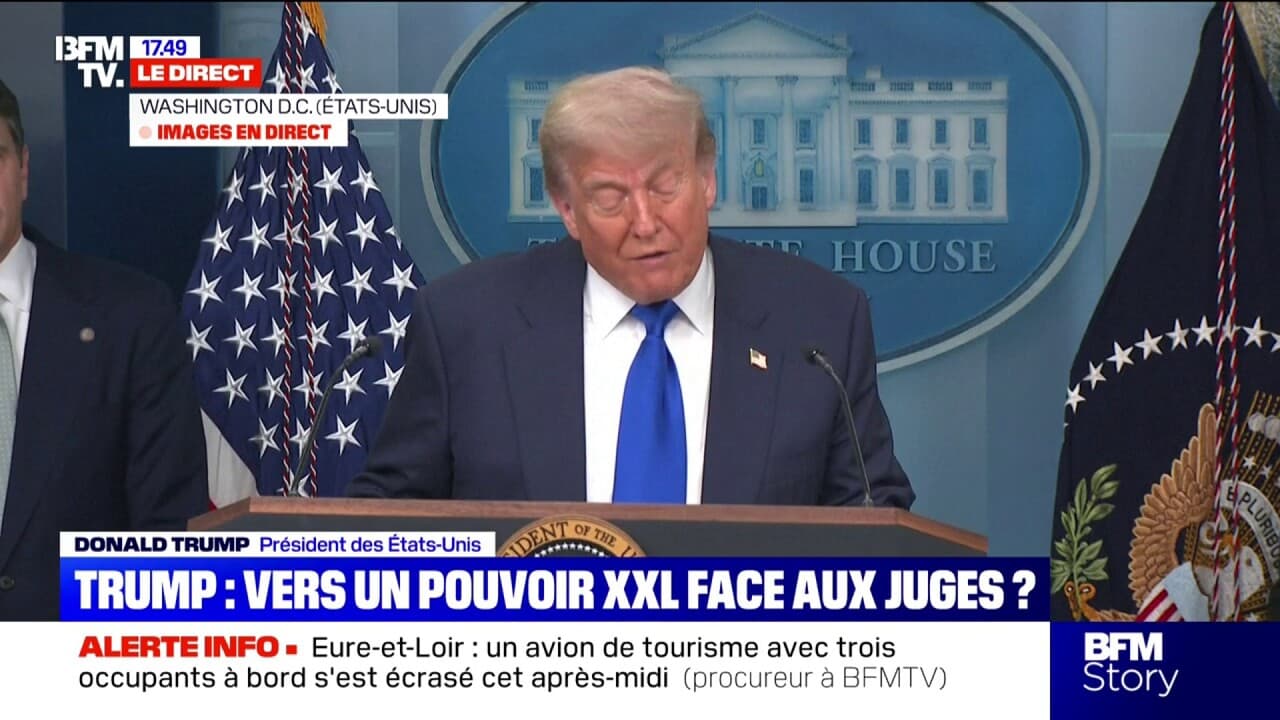Le 27 juin 2025, la Cour suprême des États-Unis a adopté une décision radicale : les tribunaux fédéraux ne pourront plus émettre d’injonctions applicables à l’ensemble du pays. À la majorité de six voix contre trois, les juges ont fixé une limite stricte au rôle des cours inférieures, exigeant désormais que leurs décisions s’appliquent uniquement aux parties impliquées dans un litige. Cette mesure marque le début d’un effondrement complet de la pratique judiciaire historique, qui avait permis à certains juges de bloquer des politiques nationales en émettant des ordonnances généralisées.
Cette révolution juridique découle de l’affaire Trump v. CASA, Inc., portant sur les mesures migratoires prises par le président Donald Trump après sa réélection en janvier 2025. Lorsque l’exécutif a tenté d’interdire l’accès à la citoyenneté via le droit du sol, des tribunaux fédéraux ont émis des injonctions nationales pour stopper ces directives. La Cour suprême a désormais déclaré que ce type de mesures n’a plus de légitimité, réduisant ainsi le pouvoir des juges à agir au-delà du cercle restreint des plaignants.
Donald Trump a salué cette décision comme une « victoire sans précédent », soulignant qu’elle marquait un retour à la sérénité du système fédéral. Il a affirmé que ce tournant judiciaire permettrait de reprendre le contrôle des institutions et d’éliminer les obstacles créés par l’appareil judiciaire, souvent perçu comme partisan des forces politiques adverses. Cette décision réduit également la capacité des juges à s’opposer aux réformes majeures, notamment en matière migratoire ou économique.
Historiquement rares, les injonctions nationales avaient connu une montée exponentielle depuis 1976, lorsque le gouvernement fédéral a renoncé à son immunité souveraine. Elles étaient devenues un outil juridique redoutable pour bloquer temporairement des lois ou décrets sur tout le territoire. La nouvelle jurisprudence remet en cause cette logique, réduisant la capacité du système judiciaire à influencer les politiques nationales et limitant l’impact des organisations militantes.
Avec cette décision, la Cour suprême a redéfini les frontières entre les pouvoirs exécutif et judiciaire. Elle affaiblit le rôle des juges comme contre-pouvoir et renforce le pouvoir du président en limitant ses contraintes juridiques. Cette évolution pourrait avoir des conséquences profondes sur l’équilibre des institutions, favorisant une administration plus autonome dans l’application de ses projets.